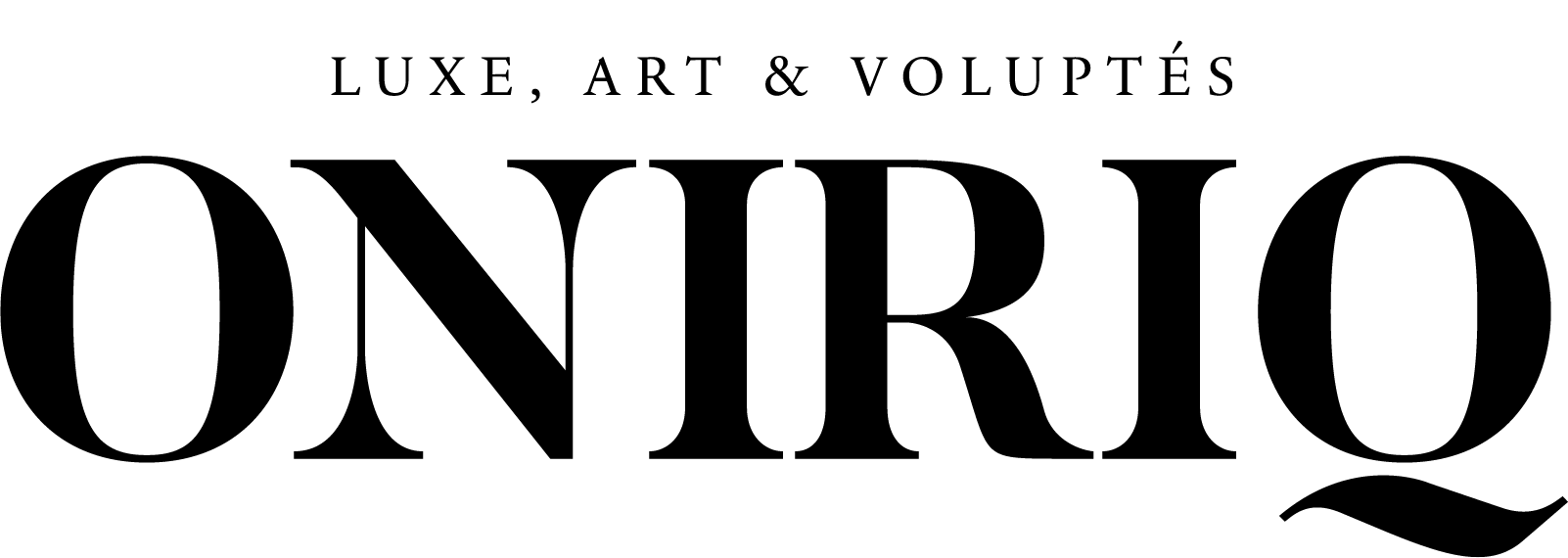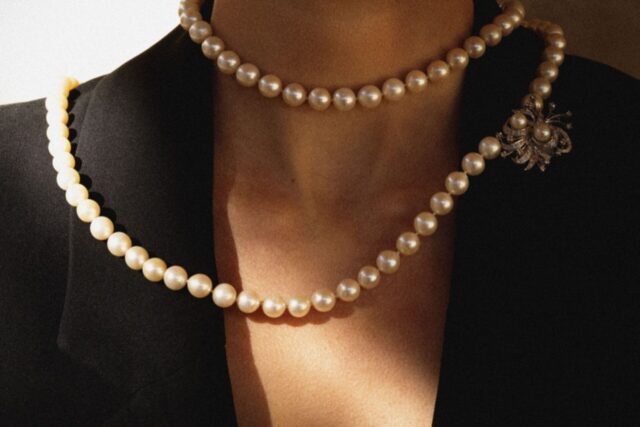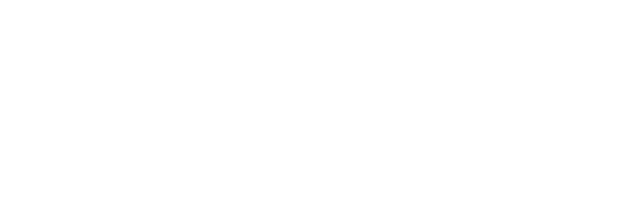Étiqueter Suzan Frecon est un exercice voué à l’échec. Son œuvre échappe aux catégories faciles, et pourtant, il suffit de réfléchir à ce que la peinture fait de plus essentiel : provoquer une émotion. Imaginez votre adolescent, traîné de force dans une galerie, lâchant d’un ton boudeur devant l’une de ses toiles : « je ne vois pas l’intérêt, je pourrais le faire moi-même. » Suzan Frecon est alors le cas d’école idéal. Car ce qui, de prime abord, peut sembler d’une simplicité presque désarmante, quelques aplats de couleur, des formes aux contours géométriques, se révèle d’une complexité insoupçonnée dès lors qu’on prend le temps de regarder.

Une abstraction américaine faite de lenteur, de lumière et de silence
Frecon peint lentement, dans la durée. Ses toiles, nourries par un savoir-faire patient, sont faites de pigments qu’elle prépare elle-même, de couches superposées, d’huiles longuement travaillées. Tout réside dans le temps passé à élaborer des contrastes subtils, entre surfaces mates et brillantes, entre transparences et opacités. Sous l’effet de la lumière, ces œuvres s’animent, dévoilent des détails insoupçonnés. Plus on s’attarde, plus elles se révèlent. « Une fois que vous avez vu ces peintures, disait-elle, vous voulez revoir cette lumière qu’elles capturent. »
Son exposition The Light Factory, qui vient de s’achever à la galerie David Zwirner à Paris, rassemblait des œuvres récentes où l’artiste prolonge sa réflexion sur la matière et la perception. Dans two blues 1 (2024) ou embodiment of red version 14 (2023), les pigments qu’elle broie elle-même jouent avec la lumière, produisant des effets presque tactiles. Chez Frecon, la composition est un instrument de tension visuelle : chaque ligne, chaque ellipse, chaque rupture de ton est calculée pour troubler le regard.

Suzan Frecon, une grande voix féminine de la peinture contemporaine
« Je n’utilise les mesures que pour des raisons visuelles, confiait-elle récemment à John Yau. Pour essayer de donner de la force à la composition des tableaux. Ce sont des mesures visuelles : ni philosophiques, ni théoriques, ni métaphoriques, ni symboliques, ni quoi que ce soit. Toutes mes décisions sont prises pour des raisons visuelles. » Cette déclaration résume bien sa rigueur : tout, chez Frecon, est affaire de regard et d’équilibre, d’ajustement patient entre construction et émotion.
Née en 1941 à Mexico, en Pennsylvanie, Suzan Frecon a étudié à l’École des Beaux-Arts de Paris dans les années 1960. Elle y découvre les fresques médiévales, les primitifs italiens, Cézanne ou Velázquez, et comprend que la lumière est un sujet en soi. De retour à New York, elle s’impose lentement dans un milieu artistique dominé par les hommes, construisant une œuvre d’une cohérence rare. En 2022, elle est élue à l’American Academy of Arts and Letters, avant de recevoir cette année le prix Alexej von Jawlensky.
Son abstraction, souvent rapprochée du Color Field Painting, s’en distingue pourtant : là où Rothko cherchait la transcendance, Frecon vise l’incarnation. Ses toiles ne sont pas des portes d’accès vers l’invisible, mais des surfaces habitées, où la lumière devient un matériau à part entière. Comme le note l’historien Richard Shiff, son œuvre semble « suspendue dans une toile d’araignée sensorielle et vivante ».
Suzan Frecon revendique ses filiations : Cézanne pour la rigueur de la construction, Morandi pour l’économie des moyens, les fresques gothiques pour la spiritualité de la lumière. Artiste d’atelier, discrète et obstinée, elle poursuit depuis plus d’un demi-siècle la même quête : celle d’une peinture qui se vit plus qu’elle ne se regarde.
À l’heure où l’on consomme l’art à coups de stories et de selfies, Frecon nous rappelle que la peinture n’est pas un décor, mais un espace d’expérience. Regarder l’une de ses toiles, c’est apprendre à voir autrement, lentement, intensément, dans le silence.
* extraits d’entretiens sont issus d’une conversation entre Suzan Frecon et John Yau pour The Brooklyn Rail.
Actualité de Suzanne Frecon
Suzan Frecon vient de recevoir le prix Alexej von Jawlensky 2025, décerné par la ville de Wiesbaden (Allemagne), rejoignant ainsi des figures comme Agnes Martin, Ellsworth Kelly ou Frank Stella. Le jury a salué « la cohérence et la persévérance de son exploration des possibilités et des limites de la peinture ». Une rétrospective majeure lui sera consacrée en 2027 au Museum Wiesbaden. L’artiste travaille actuellement à un nouveau cycle d’œuvres sur papier autour de la lumière, du temps et du geste.